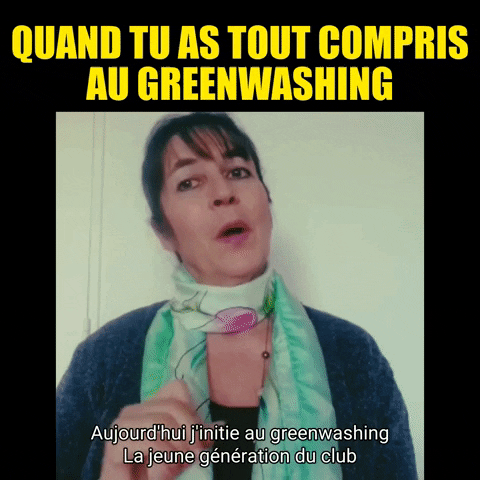La compensation carbone, c’est fini ? ☠️
Bonjour à vous, les explorateurs du futur,
On est super contents de vous retrouver pour la quatrième édition de Nouvel Air ! Ça fait quelques temps que nous n’avons pas publié mais c’est normal : à mesure que nos recherches s’affinent, on a de moins en moins de temps à consacrer à la newsletter. On préfère donc un format mensuel pour que la qualité reste au rendez-vous.
On reste sur le thème des marchés carbones pour cette édition. Cette fois-ci pour parler du marché volontaire, le petit frère du marché obligataire dont on vous parlait le mois dernier. Celui-ci est au cœur de l’actualité climat depuis que SBTi (LE dispositif mondial #1 qui pousse les entreprises à réduire leurs émissions) a annoncé que les crédits carbones seront pour la première fois acceptés - sous conditions - dans leur prochaine méthodologie.
Cette décision a fait grand bruit, avec une levée de boucliers de la part d’une partie de leurs propres équipes qui crie au greenwashing. Pourtant ce mécanisme n’est pas nouveau et on retrouve des premiers exemples de contribution volontaire depuis 2000.
Au menu de cette édition :
Le B.A.-BA du marché carbone volontaire : comment ça marche et pourquoi tout le monde en parle ?
Nos petites aventures et ce qu'on a découvert sur le sujet en parlant à des experts.
La partie formation pour les aspirants entrepreneurs sur les incubateurs, accélérateurs et startup studios.
On a hâte de partager avec vous ce qu'on a déniché 😄. Pas encore à bord ? Il n'est pas trop tard pour nous suivre ! Vous pouvez vous inscrire par ici :
Retour sur le marché volontaire du carbone
On a évoqué le sujet du Marché Volontaire du Carbone (VCM) - les fameux “crédits carbones” - dans la dernière édition, mais on est resté un peu sur notre faim. On entend le tout et son contraire sur la question dans les médias ou les dîners mondains. Comme c’est un sujet passionnant et une brique dans la lutte contre le dérèglement climatique, on s’est dit qu’on allait refaire un petit topo. Voici un rappel rapide du fonctionnement (issu de la dernière édition, pour les rares lecteurs qui l’auraient ratés 😉) :
Ce marché offre l’opportunité à des entreprises ou particuliers d'acheter des crédits carbone de leur propre initiative, auprès de porteurs de projets environnementaux. Chaque crédit représente une tonne de CO2 qui a été réduite, évitée ou séquestrée grâce à ces projets environnementaux. Les projets peuvent être de nature différente : reforestation, parcs éoliens, agriculture régénératrice…
D’un côté, cela permet de financer des initiatives de réduction des émissions dans le monde entier. De l’autre, c’est une façon pour les entreprises de montrer leur engagement en faveur de l'environnement et de contribuer à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Un exemple vaut mille mots : je suis exploitant de forêt, je plante 30 arbres qui vont absorber 100 tonnes de CO2 sur leur durée de vie, je peux valoriser cette absorption en vendant 100 crédits carbone à une entreprise volontaire - il n’y a aucune obligation pour l’entreprise en question d’acheter le crédit.”
Malgré ce fonctionnement qui semble assez simple et clair sur le papier, nous allons voir que ce n’est pas aussi simple que ça. Dans les faits, les crédits carbone sont source de nombreuses accusations de greenwashing (ie : des pratiques marketing utilisées par une entreprise pour donner une image écologique trompeuse de ses produits, services ou pratiques générales, afin de paraître plus responsable environnementalement sans que cela ne soit justifié par des actions concrètes).
Le marché du carbone volontaire, un petit marché en forte expansion ?
Le marché du carbone volontaire est encore modeste comparé à ses frères les marchés régulés : en 2022, le premier a été évalué à près de 2 Mds$ vs 900 Mds$ pour les seconds.
En revanche, la croissance énorme du marché volontaire sur les dernières années, de 100M$ en 2020 à 2,1Mds$ en 10 ans, a toutes les chances de se poursuivre par la suite : Bloomberg estime la taille de marché entre 10Mds$ et 40Mds$ en 2030.
Pourtant, le marché a subi un coup d’arrêt et a stagné entre 2021 et 2022 de 2,1Mds$ à 2Mds$. Comment l’expliquer ?
Cela s’explique en grande partie par des scandales, dont vous avez peut-être entendu parler et que nous allons détailler un peu plus bas. La conséquence ? Une baisse des contributions volontaires des sociétés pour éviter d’être accusées de Greenwashing.
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises préfèrent ne rien faire plutôt que de mal faire…On assiste même à un nouveau phénomène, le Greenhushing : certaines entreprises préfèrent ne pas divulguer leurs initiatives écologiques par peur de la critique ou par incertitude sur la fiabilité de leurs données environnementales.
Le marché est aujourd’hui partiellement cassé et a besoin d’être réparé. En général, c’est synonyme d’opportunités pour les entrepreneurs.
Les crédits carbones : un mécanisme très vertueux sur le papier
Pour commencer, un petit passage technique s’impose pour mieux comprendre le mécanisme, et s’attarder dans un deuxième temps sur les scandales récents.
Au cœur du système de compensation carbone, on trouve plusieurs acteurs clés :
Le porteur de projet, qui initie une action spécifique pour réduire ou capter le CO2 (comme la reforestation ou la construction d'installations d'énergie renouvelable) peut émettre des crédits carbone et les vendre.
Les entreprises souhaitant compenser leurs émissions achètent les crédits carbone.
Un label est nécessaire pour assurer l'intégrité du système : il certifie la méthodologie du projet, garantissant ainsi que chaque crédit représente une véritable réduction des émissions de CO2. Parmi les label les plus connus on retrouve Verra, Gold Standard, ou encore le Label Bas Carbone en France.
Plusieurs intermédiaires ou tiers de confiance jouent un rôle crucial sur ce marché : ils assurent la partie administrative, la vente ou l'achat des crédits carbone de la manière la plus transparente et fiable possible. Ces intermédiaires peuvent aussi proposer des outils de MRV (Measure, Report, Verify) pour suivre et vérifier l’impact sur le CO2. C’est souvent là où se lancent les projets entrepreneuriaux digitaux comme le notre 😉.
Il y a deux types de crédits carbones :
Les crédits de réduction sont générés par des projets qui diminuent directement les émissions de CO2, comme l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'utilisation de technologies propres.
Les crédits d'absorption proviennent de projets qui captent et stockent le CO2 de l'atmosphère, typiquement à travers la reforestation, l'agriculture régénérative ou encore la capture carbone.
Enfin, pour en finir sur la technique, il faut savoir qu’il y a 5 critères à respecter, afin qu’un crédit puisse être émis :
L'additionnalité : ce critère garantit que le projet n’aurait pas pu être mis en œuvre sans la vente des crédits carbone.
→ Le porteur de projet doit montrer que sans l’argent lié à la vente de crédits carbone, la forêt serait coupée.
Mesurabilité : les réductions d'émissions doivent être quantifiables en utilisant des méthodes reconnues et fiables. Cela permet de déterminer précisément le nombre de crédits à émettre en fonction des tonnes de CO2 réduites.
→ On est capable de calculer combien de CO2 un arbre absorbe chaque année.Vérifiabilité : il doit être possible pour des tiers indépendants de vérifier et valider les résultats annoncés du projet. Cela assure l'authenticité et la transparence des réductions d'émissions revendiquées.
→ Un auditeur tiers doit être en mesure de passer voir la forêt chaque année pour s’assurer que l’arbre est toujours là.Permanence : l’évitement ou la séquestration de carbone doit avoir lieu sur la durée (en général minimum 7 ans). Ces critères sont définis précisément dans les différentes méthodologies de certification des projets.
→ Les arbres concernés doivent être protégés de la coupe et des incendies pendant la période définie.L'unicité : chaque crédit carbone doit être unique pour éviter le double comptage.
→ La vente du crédit et son retrait sont inscrits sur un Registre géré par le Label, ce qui permet de s’assurer que le crédit n’est pas vendu deux fois.
Complexe… mais captivant. À première vue, tout cela semble infaillible, non ? Mais d'où proviennent alors tous ces scandales ?
La réputation entachée des crédits carbones
Pour commencer, il faut comprendre que fondamentalement le concept de “compensation” (ou de neutralité carbone d’un produit / d’une entreprise) n’a pas de sens. Cela pour plusieurs raisons :
Premièrement, une entreprise souhaite compenser une émission passée en achetant un crédit carbone. Pourtant, l’un des principaux avantages des crédits carbones est de financer des projets futurs. Vous voyez le problème ? La tonne de carbone dont la compensation est prévue a, dans la réalité, déjà été émise, ce qui crée un décalage temporel - avec un impact négatif non négligeable. Pendant que nous attendons l'effet de ces projets, les émissions continuent de s'accumuler dans l'atmosphère.
Ensuite, la notion de permanence pose également problème. Théoriquement, pour que la compensation soit effective, la permanence des effets du projet devrait être infinie. Cependant, très peu de projets peuvent garantir une telle durabilité, surtout face aux menaces comme le changement d'usage des terres, les catastrophes naturelles ou les changements politiques et économiques.
Enfin, ça n’a pas de sens de parler de neutralité carbone d'un produit, d'une entreprise ou même d'un État. Nous vivons dans un monde globalisé où les émissions de carbone ne connaissent pas de frontières. L'impact de toute activité économique ou de consommation est donc global, rendant la notion de neutralité carbone par entité trompeuse.
Finalement, la seule tonne de CO2 qui a véritablement été compensée est celle qui n’a jamais été émise.
Ces problèmes fondamentaux, associés à des erreurs méthodologiques imprévues ou parfois même à des pratiques malhonnêtes, ont engendré plusieurs types de scandales notables dans le domaine des crédits carbone :
Des problèmes d’additionnalité : des crédits carbone peuvent être vendus pour protéger des forêts qui sont menacées d’être coupées. Cependant, certains projets ont été certifiés alors que la forêt en question était déjà sous protection légale - ce qui signifie que la vente de ces crédits n'apporte aucun bénéfice additionnel en termes de réduction des émissions… C’est le cas par exemple d’une partie des forêts concernées par le scandale Verra révélé par le Guardian en 2018.
Les “Effets de fuite” : bien que certains projets protègent des zones forestières, la déforestation s’intensifie parfois juste à côté, annulant ainsi les bénéfices environnementaux escomptés.
Le fameux "Effet rebond" : ce phénomène se produit lorsque des améliorations en efficacité énergétique conduisent, contre toute attente, à une consommation accrue. Prenons l'exemple des crédits carbone associés aux cookstoves (cuisinières) dans les pays en développement :
Ces crédits financent le remplacement de vieux modèles polluants par des versions plus modernes et efficaces.
Cependant, au lieu d'abandonner leurs anciens équipements, 50% des utilisateurs les conservent, utilisant simultanément les deux appareils pour cuisiner plus rapidement.
Au total, les émissions nettes de CO2 sont finalement plus élevées qu’en l’absence de ces crédits carbone.
Pour les intéressés, on vous conseille cette vidéo Youtube de la chaîne Wendover qui résume très bien ces différents scandales.
Grosso modo, les crédits carbones peuvent parfois ressembler à un Eldorado pour les entreprises cherchant à soigner leur image, orchestrer une opération marketing, ou même embellir leur bilan carbone afin de séduire des investisseurs. Les îles caïmans du Greenwashing en quelque sorte.
La solution pour le marché : de la compensation carbone à la contribution carbone volontaire
Un nouveau paradigme est apparu sur le marché depuis quelques années sous l’égide de SBTi dont nous avons parlé en intro. Chaque entreprise engagée SBTi (Science Based Target initiative) doit proposer une trajectoire de réduction de ses émissions alignées avec les objectifs d’un monde “net zero” en 2050 (net zero : un équilibre entre les émissions de CO2 émises et celles retirées de l'atmosphère, visant un impact carbone nul pour stabiliser le climat en accord avec les accords de Paris). Le consensus est mondial : la priorité est donnée aux réductions plutôt qu’à la compensation.
En revanche, l'urgence climatique requiert que nous mobilisions tous les moyens disponibles pour agir. Net Zero Initiative (lancée par Carbone 4, le cabinet de conseil de Jean-Marc Jancovici) propose une approche en trois étapes :
Mesurer ses émissions
Réduire ses émissions de -3 à -7% par an pour atteindre les objectifs “net zero”
“Contribuer” dès aujourd’hui pour atténuer les effets négatifs des émissions résiduelles (ie : les émissions qui ne sont pas encore réduites)
La “contribution” est ici entendue comme le recours à des crédits carbone de qualité.
On bannit l’usage du terme de “compensation”, qui n’a pas de sens comme vu plus haut.
À la place, on incite les entreprises à investir dès aujourd’hui dans des projets qui rapprochent la planète du net zero.
Certaines (rares) entreprises vont même jusqu’à contribuer jusqu’à x2-x3 par rapport à leurs émissions résiduelles afin de réduire au maximum les éventuels problèmes d’additionnalité ou de permanence des projets.
Si on fait de la contribution, il faut le faire bien. Qu’entend-t-on par un crédit carbone de qualité ?
Priorité à l'absorption plutôt qu'à l'évitement : les crédits qui financent des projets d'absorption de CO2, comme la reforestation ou la restauration des sols, sont souvent plus bénéfiques que ceux qui se contentent d'éviter de nouvelles émissions, comme la préservation des forêts existantes. Ces derniers, bien que valides et importants, peuvent parfois maintenir le statu quo plutôt que de contribuer activement à la réduction des gaz à effet de serre.
Une MRV rigoureuse : la méthodologie de Measure, Report, Verify doit être la plus précise possible. Une bonne MRV assure non seulement que les réductions d'émissions sont réelles et vérifiables, mais renforce également la confiance dans l'intégrité du projet. Les outils digitaux sont cruciaux sur ce point.
Investir en local et dans sa chaîne de valeur : investir dans des projets proches de l’entreprise, que ce soit géographiquement ou par les activités économiques, permet d’améliorer la transparence sur la destination de l'argent investi. En décarbonant mon fournisseur grâce à l’achat d’un de ses crédits carbone, je réduis d’ailleurs mes propres émissions sur mon scope 3 (sur les émissions liés à mes achats), ce qu’on appelle l’insetting par opposition à l’offsetting.
Inclure et valoriser les co-bénéfices : les projets de qualité ne se limitent pas à la capture ou à la réduction de CO2 ; ils contribuent également à la biodiversité, à l'amélioration des conditions de vie locales, à la résilience économique des communautés… Valoriser ces co-bénéfices enrichit l'impact global du projet.
S’adosser à de nouveaux labels plus exigeants : des initiatives telles que Riverse (cocorico 🇫🇷 !) cherchent à redéfinir les standards des crédits carbone en intégrant tous ces éléments, poussant les acteurs établis à améliorer leurs pratiques.
Les tendances récentes sur le marché volontaire du carbone sont donc très prometteuses : le nombre de crédits vendus en 2022 a beau être deux fois moins élevé qu’en 2021, le prix de chaque crédit est lui quasiment deux fois plus élevé : 7,37$ la tonne 2022 vs 4,04$ en 2021.
On est encore loin du pic à 100$ la tonne sur le marché obligataire… mais la dynamique de premiumisation des crédits reste positive. Pour preuve, le prix moyen d’un crédit certifié par le Label Bas Carbone était de plus de 32€ en 2022 ! On espère que le marché des crédits carbone pourris à 1$ la tonne est définitivement derrière nous. Pour notre part, nous sommes assez confiants 😉.
Quel avenir pour le crédit carbone ?
Certains parlent d’intégrer dans le marché obligataire des crédits carbone 100% vérifiables à un prix élevé. Ceci catalyserait l'innovation et stimulerait la restauration des écosystèmes grâce à des milliards d'euros investis. Des preuves de concept (POC) existent déjà, comme CORSIA ou l’obligation pour les compagnies aériennes de compenser les émissions des trajets domestiques via l’achat de crédits certifiés par le Label Bas Carbone.
Le end-game serait que le prix du carbone dépasse enfin le coût social du carbone (c’est à dire l’estimation monétaire des dommages environnementaux et sociaux causés par l'émission d'une tonne de CO2, environ 120€ et 150€ de coût pour la société quand une tonne de CO2 est émise).
Le marché volontaire du carbone n’est pas la panacée. Il ne suffit pas, loin s’en faut, mais il peut selon nous réellement aider et contribuer à un monde net zero.
Notre échange avec un expert du marché carbone volontaire
Au cours de nos pérégrinations, nous avons pu voir de nombreux très beaux projets sur ce marché. L’une des personnes qui nous a le plus aidé est Luc Bailly, fondateur de Resoil - un sublime projet qui vise à développer l’agriculture régénératrice en France.
Nous souhaitons vous partager nos échanges qui pourraient peut-être susciter de nouvelles vocations. En tout cas, chez nous ça a eu son petit effet pour nous motiver à creuser ce marché !
[AAO] Peux-tu nous expliquer rapidement comment fonctionne Resoil ?
[LB] La mission de ReSoil est de favoriser la transition vers une agriculture durable pour la planète, viable économiquement pour les agriculteurs et comprise par tous :
D'une part, nous accompagnons les agriculteurs français dans leur transition vers l'agriculture régénératrice à travers un soutien agronomique et financier - via l’émission de crédits carbone.
D'autre part, nous les connectons avec les entreprises qui dans le cadre de leur stratégie climat financent ces puits de carbone agricoles avec un impact positif sur la biodiversité - via l’achat de crédits carbone.
[AAO] Le crédit carbone dans l’agriculture, c’est nouveau ?
[LB] Pas du tout, ça existe depuis des années. En revanche, le marché s’est beaucoup développé récemment (+300% par an sur le segment de Resoil)
Notre grande force par rapport aux autres acteurs, c’est d'être l'unique intermédiaire entre l'agriculture et l'entreprise contributrice. C'est à dire d’accompagner l’agriculteur sur l’ensemble de son projet carbone de l’émission du crédit à la vente.
C’est un marché très intermédié. C’est pourquoi on répond à un vrai problème sur le marché en proposant une solution unique pour à la fois mieux rémunérer les agriculteurs pour leur changement de pratiques et maximiser l'impact du financement de l'entreprise qui achète les crédits carbone.
[AAO] Comment expliquer l’essor actuel de ton marché, alors qu’on entend partout que le marché volontaire a stagné récemment ?
[LB] En fait, tous les crédits carbones ne se valent pas et nous avons fait le choix de nous concentrer sur des crédits carbones premiums :
Nos crédits sont certifiés Label Bas Carbone, le registre de l’État Français qui est l’un des plus qualitatifs sur le marché.
Nos projets incluent et suivent des indicateurs de co-bénéfices : sur l'état de santé des sols, la biodiversité, la qualité de l'eau et de l'air etc.
Enfin, nous essayons au maximum de vendre nos crédits en “circuit-court”.
[AAO] En circuit-court ? Comme pour les fruits et légumes ? 😅
[LB] C’est le petit nom qu’on donne aux crédits carbones vendus :
Localement : une entreprise française achète un crédit français.
Dans sa chaîne de valeur : un industriel agroalimentaire qui achète un crédit carbone auprès de son fournisseur. En aidant ainsi l’agriculteur à décarboner ses activités, l’industriel en profite pour améliorer lui-même son bilan carbone.
[AAO] C’est ce qu’on appelle l’insetting c’est ça ?
[LB] Exactement :
l’insetting est basé dans ce cas sur la vente d’un crédit carbone.
Mais Resoil peut également accompagner la mise en place d’un accord commercial entre l’industriel et l’agriculteur : l’industriel est prêt à payer un premium pour une matière première (du blé par exemple) décarboné. On appelle ça alors la prime filière.
[AAO] C’est hyper intéressant, j’imagine que ça se développe de plus en plus. Est-ce que tu as vu des problématiques ou des opportunités pour lancer une boite sur ce marché ?
[LB] Selon moi, on est qu’au début de l’histoire sur le marché du carbone volontaire. Malgré tous les débats récents, je suis d’accord avec Net Zero initiative : c’est une brique essentielle pour un monde décarboné. Il y a donc tout à faire :
apporter de la transparence et mettre en avant les acteurs qui suivent les bonnes pratiques sur le marché.
lancer de nouvelles méthodologies sur d’autres secteurs à décarboner (industrie, transport, rénovation énergétique etc). Par exemple, en regardant les chantiers en cours côté Label Bas Carbone.
mieux inclure les enjeux liés à la biodiversité ou l’usage de l’eau dans le mécanisme de crédits carbones
je pense même qu’il y a un truc à faire pour du crédit carbone premium en B2C : il y a une grande défiance, probablement à raison, sur les options de compensation pour les particuliers. Pourtant, on pourrait faire des merveilles pour financer des projets positifs pour la planète avec une contribution qualitative.
[AAO] On va creuser ça 😉, merci pour ton aide Luc !
Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas de notre côté, on a eu l’impression de pouvoir déplacer des montagnes après ce RDV. Les pistes évoquées par Luc nous semblent ultra-prometteuses. On le voit bien, d’autres super startups sur le sujet semblent prouver que le marché converge pour se réparer : Labels 2.0 (Riverse), nouveaux puits de carbone (CarbonFarm), MRV plus précise via satellites (Pachama qui a levé 100M$), prise en compte des enjeux biodiversité (Abundant Earth)…
Bientôt un projet sur le marché carbone volontaire pour Nouvel Air ? On regarde de près, mais si vous avez des idées on est preneurs !
[Le moment formation] Comprendre les structures d'accompagnement pour les startups : Incubateurs, Accélérateurs, Startups Studios
En discutant avec certains de nos amis et proches qui sont des lecteurs assidus de cette newsletter, nous avons réalisé que la différence entre incubateurs, accélérateurs et startups studios est souvent mal comprise.
Nous avons donc décidé de prendre le temps de clarifier cela pour tout le monde, en fournissant une vue d'ensemble et en expliquant les rôles spécifiques de chaque type de structure.
Tout dépend du stade d'avancement de votre projet et de ce que vous recherchez.
Je suis seul et je n'ai pas d'idée, mais je veux entreprendre
Dans ce cas, vous pourriez considérer les Startups Studios. Ces structures sont conçues pour aider les individus qui ont l'élan entrepreneurial mais qui n'ont pas encore d'idée concrète ou de co-fondateurs.
Concrètement, un startup studio trouve des idées de startups, trouve ensuite des cofondateurs, puis finance le lancement de la société jusqu’à la première levée de fonds.
En contrepartie, le studio va prendre du capital de la startup (entre 30% et 60% selon les studios)
L’exemple le plus connu de startup studio est Hexa (anciennement efounders, une référence en Europe avec à son actif plusieurs grands succès comme Spendesk, Aircall ou Front). On peut également citer quelques startups studios spécialisés dans l’impact / la Climate Tech : Jumanji, Imagination Machine, Marble.
NB : il est également possible d'approcher des startups studios si vous avez déjà des associés ou même une idée. Cependant, dans ce cas, il est crucial que le startup studio puisse apporter une valeur ajoutée pour justifier le partage du capital. Il sera également nécessaire de négocier le montant du capital à partager.
Ce qu’on en pense :
On sait que dans l’entreprenariat l’idée est loin d’être la seule composante du succès. Ce qui compte surtout c’est l’exécution (l’idée de départ risque de changer, c’est votre capacité à vous adapter et à executer efficacement qui feront réellement la différence).
Assurez-vous bien que l’accompagnement du studio au delà de l’idée mérite le capital que vous allez leur laisser. Quel est le montant du financement ? Comment est-ce qu’ils vous accompagnent dans l’exécution ? Est-ce qu’il y a des ressources transverses pour vous faire gagner du temps (RH, Admin etc…) ? Est-ce qu’il y a un réseau d’alumni qui peut être valorisé ?
De notre côté nous n’écartons pas la possibilité de monter notre prochaine entreprise avec un studio. Nous explorons même des pistes avec certains.
Une autre solution si vous êtes seul et sans idée est de rejoindre un programme comme Entrepreneur First ou Antler. Il est difficile de les mettre dans une case car ils ne sont ni des incubateurs ni des studios. Ces programmes se concentrent sur l'identification de talents individuels et les aident à trouver des co-fondateurs, à développer des idées et à lancer leur entreprise.
Nous avons eu de très bon retours d’expériences sur ces programmes.
J'ai déjà une idée, avec ou sans associés
Si vous avez déjà une idée de startup et que vous cherchez à la structurer, trouver des associés et à obtenir un financement initial tournez vous vers les incubateurs.
Les incubateurs sont de toutes sortes avec différents modèles. En général, on paie un prix mensuel pour les postes de travail, et l’incubateur met a disposition un réseau d’experts pour un accompagnement business et/ou technique.
Exemples d'incubateurs :
Les incubateurs des grandes écoles : Incubateur HEC, Arts et Métiers (pour les projets de startup industriels), 21st by Centrale Supelec (À la fois incubateur et accélérateur)
Station F : situé à Paris, c'est l'un des plus grands incubateurs de startups au monde, offrant un espace de travail et un soutien aux startups en phase de démarrage.
Schoolab : un incubateur historique qui, en plus de superbes locaux et d’accompagnement en physique, propose également un programme 100% en ligne, éligible au CPF.
Ce qu’on en pense :
Nous en avons fait plusieurs à l’époque du lancement de Pulp.
D’après notre expérience, le principal intérêt réside dans l’accès à des bureaux abordables et les rencontres avec d’autres entrepreneurs au même stade d’avancement.
Nous avons été déçus de notre expérience à Station F où l’espace était tellement grand et avec tellement de turnover que c’était finalement moins propice aux rencontres que d’autres incubateurs plus petits.
Il y en a une multitude donc regardez bien ce qu’ils proposent ! Attention aux frais et prudence avec les structures qui prennent du capital.
J'ai déjà une structure et des premiers clients
Si votre startup est déjà structurée et que vous avez des premiers clients, vous pourriez envisager de rejoindre un accélérateur. Les accélérateurs sont conçus pour aider les startups à croître rapidement, en fournissant des ressources, des mentors et parfois même un financement. Les bureaux deviennent alors une partie accessoire et non systématique dans leur offre.
Là encore il en existe des centaines avec une multitude de modèles différents. On ne peut pas tous les citer.
Quelques exemples d'accélérateurs :
Wilco : accélérateur pour les startups d’île-de-France qui propose également du financement non dilutif.
Réseau Entreprendre : sans être réellement un accélérateur, les missions de cette association d’entraide entre entrepreneurs se rapproche de la proposition des programmes d’accélération. Accompagnement par un mentor et financement non dilutif.
Breakthrough Energy Fellows : un programme d'accélération dédié aux innovations en matière d'énergie propre. Il est adossé au fond d’investissement Breakthrough Energy Ventures fondé par Bill Gates.
Techstars : avec des programmes dans le monde entier, Techstars est un des accélérateurs les plus gros au monde. À Paris ils ont un programme d’accélération axé “sustainability” dont on a entendu le plus grand bien.
Y Combinator : basé dans la Silicon Valley, c'est l'un des incubateurs les plus connus, ayant aidé des startups comme Airbnb et Dropbox. On en parle souvent et on recommande vivement leurs cours d’entrepreneuriats en ligne.
Ce qu’on en pense :
On recommande Wilco à tous les entrepreneurs que l’on croise ! 2 gros points forts : un super réseau d’alumni qui peut intervenir en tant que mentors et du financement non dilutif of course.
Regardez bien quel est le business model de l’accélérateur. Si c’est gratuit pour vous et que des entreprises payent, c’est que c’est vous le produit ⇒ certains peuvent vous imposer des obligations qui sont une réelle perte de temps. Faites bien attention à ça.
En conclusion : Startup Studio = foncez si vous vous sentez l’âme d’un entrepreneur mais que vous galérez vraiment à trouver une idée et/ou des associés.
Le reste : ça peut être cool si vous cherchez des bureaux et/ou des financements, mais n’y consacrez pas trop de temps de d’énergie. Certains sont très bons en marketing mais ils ne feront jamais le succès de votre startup (le ratio temps passé / valeur ajoutée pour YCombinator à SF par exemple est largement favorable, mais ce n’est pas le cas pour toutes les structures !)
Merci à tous pour votre soutien, on espère que vous avez apprécié cette édition 💥.
De notre côté, on avance dans nos recherches mais on a pas encore trouvé la pépite. Comme quoi ce n’est pas une légende, trouver une idée ce n’est pas si facile !
À nouveau, on vous met à contribution : on cherche pour une prochaine édition des experts sur le sujet des CEE (vous savez les “Certificats d’Économies d’Énergie”, dispositif Français qui incite les entreprises à mettre en place des actions pour la réduction de la consommation d'énergie) - que ce soient des acheteurs / vendeurs de CEE ou autres acteurs de l’écosystème.
À très bientôt pour de nouvelles aventures ✌️
Antoine, Arnaud et Olivier